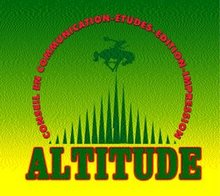Ainsi, la terre du Cameroun vient de se refermer sur l'un de ses famous journalist en la personne de Pius Njawe. L'enfant de Babouantou, notable à la chefferie, avait réussi grâce à son travail, son courage et à sa clairvoyance à se construire une notoriété bien au-delà des frontières nationales camerounaises et surtout au-delà de ces frontières. Nul n'étant prophète chez soi, c'est à l'extérieur qu'il fallait mesurer la dimension monumentale qui était celle du patron de « Free Media Group » et de l'emblématique journal "Le Messager". Pius Njawe est le self made man qui, de garçon de course et de crieur de journaux, était devenu le patron du journal le plus influent du Cameroun.
Ainsi, la terre du Cameroun vient de se refermer sur l'un de ses famous journalist en la personne de Pius Njawe. L'enfant de Babouantou, notable à la chefferie, avait réussi grâce à son travail, son courage et à sa clairvoyance à se construire une notoriété bien au-delà des frontières nationales camerounaises et surtout au-delà de ces frontières. Nul n'étant prophète chez soi, c'est à l'extérieur qu'il fallait mesurer la dimension monumentale qui était celle du patron de « Free Media Group » et de l'emblématique journal "Le Messager". Pius Njawe est le self made man qui, de garçon de course et de crieur de journaux, était devenu le patron du journal le plus influent du Cameroun.Plusieurs fois que je me trouvais hors du Cameroun et que j’ai décliné mon statut de journaliste d'origine camerounaise, la question m'était systématiquement posée de sa savoir si je connaissais Pius Njawe. Et j'ai eu l'impression que c'est seulement la réponse affirmative à cette question qui permettait à mes interlocuteurs de valider ma qualité de journaliste. C'est dire si, sans qu'il en soit même conscient, Pius Njawe, était devenu, une légende, une sorte de donneur de l'onction journalistique par delà tous les diplômes qu’on peut prétendre dans ce métier. Comme le dirai Albert Mbida, Pius Njawe était un vrai médecin de la profession des journalistes en ce sens qu’il a permis à plusieurs personnes de se guérir de la « diplomite », cette maladie qui fait croire à ses victimes que seul le diplôme d’une grande école de journalisme confère le statut de journaliste.
La première fois que j’avais rencontré Pius Njawe, c’était en 1990. Je venais de publier mon premier papier de journaliste dans « Le Messager ». Ce qui était en soit une consécration pour le journaliste en her
 be que j’étais. Après l’affaire Monga-Njawe-le Messager et le ramdam qui avait entouré ce procès, j’ai décidé de faire le voyage de Douala pour rencontrer mon idole. L’image qu’il m’avait laissé, c’est celle d’une personne qui méprise jusqu’à l’inconscience, ce que nous pouvons considérer comme danger. J’avais fait la même démarche auprès de Célestin Monga et plus tard auprès de Jean Baptiste Sipa qui lui résidait à Yaoundé. Il faut dire qu’à chaque fois que j’avais rencontré ces icônes, je me gardais bien de me frotter la paume de main au moins pendant deux jours. Eh oui ! Lorsqu’on a vingt ans, il faut rêver pour quelque chose ou pour quelqu’un. Il faut avoir des étoiles qu’on suit et pour le suivi desquels on est prêt à mourir. Je pense que la jeunesse camerounaise a aujourd’hui un déficit de rêve. Et c’est dommage !
be que j’étais. Après l’affaire Monga-Njawe-le Messager et le ramdam qui avait entouré ce procès, j’ai décidé de faire le voyage de Douala pour rencontrer mon idole. L’image qu’il m’avait laissé, c’est celle d’une personne qui méprise jusqu’à l’inconscience, ce que nous pouvons considérer comme danger. J’avais fait la même démarche auprès de Célestin Monga et plus tard auprès de Jean Baptiste Sipa qui lui résidait à Yaoundé. Il faut dire qu’à chaque fois que j’avais rencontré ces icônes, je me gardais bien de me frotter la paume de main au moins pendant deux jours. Eh oui ! Lorsqu’on a vingt ans, il faut rêver pour quelque chose ou pour quelqu’un. Il faut avoir des étoiles qu’on suit et pour le suivi desquels on est prêt à mourir. Je pense que la jeunesse camerounaise a aujourd’hui un déficit de rêve. Et c’est dommage !Malgré la stature internationale qu’il avait acquise, Pius Njawe était resté d’un naturel déconcertant. Un jour, nous nous étions retrouvés dans la cour du ministère de la communication lors d’un de ses rares voyages à Yaoundé. En venant, il avait garni ses poches des arachides qu’il avait sans doute achetées dans les alentours du ministère. Et pendant que nous discutions, il faisait craquer les fruits et mangeait les fruits en laissant partir de temps à autre ce rire goguenard dont il avait seul le secret. La dernière que je l’ai rencontré, c’était à son bureau à Douala. J’étais venu lui dédicacer mon ouvrage : « Pour la dignité de l’Afrique, laissez-nous crever ». Il m’a promis toute sa disponibilité par rapport à un projet de livre sur les journalistes. Je devais donc le revoir à ce sujet. Le destin en a décidé autrement. Le sien est venu sous la forme d’un accident de circulation à mille lieux de sa terre natale.
La mort d'un journaliste n'est jamais ordinaire certainement parce que le journaliste est loin d'être un homme ordinaire. Les questions sociales et politiques sur lesquelles il se penche dans son travail quotidien finissent par faire de lui, un proche parent de tout le monde. Un proche qu’on adule, qu’on jalouse ou qu’on exècre mais qui ne laisse personne indifférent. C’est pourquoi à la mort d’un journaliste, la nouvelle fait vite le tour du monde et des clameurs montent de partout, chacun croyant qu’il vient de perdre un ami, un frère, un ennemi à qui il ne souhaitait tout de même pas la mort. Il y a aussi que le journaliste est souvent un détenteur naturel d’une chose très prisée par les hommes publics. Cette chose, c’est la notoriété. A sa mort donc, jouant de la nécromancie, tout le monde vient à la récolte de cette notoriété à travers des témoignages toujours plus flatteurs, les uns que les autres. De ces clameurs, on peut relever un certain nombre d’approximations balancées sur les journalistes et leur métier. On dit par exemple que le journalisme est le métier le plus dangereux du monde ou que les journalistes meurent trop ou encore que la mort d’un journaliste n’est jamais simple. Mais ce que je voudrais pouvoir dire, c’est que, contrairement à d’autres morts, la mort d’un journaliste doit servir à quelque chose.
Des morts en série
J'avais entamé cette réflexion sur la mort du journaliste, à la disparition de Richard Touna, un autre confrère qui avait bu à la source Pius Njawe avant de décider de voler de ses propres ailes en lançant le journal "Repères". Richard, qui mettait tant d’entrain à faire réussir son projet de journal, en affrontant des pires difficultés, avait lui aussi été arraché à la vie à la fleur de l'âge, nous laissant sans voix. Selon toute vraisemblance, il se serait presque tué à la tâche en voulant relever le défi d’un vrai patron de presse. Avant Richard, j’avais déjà subi douloureusement d’autres disparitions de journalistes qui m’étaient proches. Che Lawrence avec qui j’avais fait la campagne de « Challenge Hebdo » comme d’autres firent la campagne d’Indochine ; Atemebang Achu, un journaliste de la CRTV qui était déjà pour moi le précurseur du rapprochement entre la presse privée et la presse officielle ; Château willy Ekoro qui n’avait de cesse de saluer le fait que moi, issu de la presse privée tout ce qu’il y a de radicale, me lie d’amitié avec Atem. D’autres décès viendront compléter ce tableau macabre : Joseph Mbende, Abed Nego Messang, Isaac Mbella Essengue…
Je voudrais comprendre, à travers cette réflexion, sans vouloir jouer les enquêteurs de quoi que ce soit, ce qui, dans la pratique quotidienne de son métier, peut entrainer la mort d'un journaliste et ce qui fait de cette mort de journaliste, une chose tout à fait unique. Mon analyse s’inspirera du cas camerounais où une curieuse division classe les hommes des médias, en journalistes de la presse privée et en journalistes de la presse officielle.
On a l'habitude de dire du journalisme qu'il est l'un des métiers les plus dangereux du monde. Reporters sans frontières le fait souvent en égrainant la liste des journalistes mort en faisant leur métier. Ce qui est évidemment impressionnant. Je ne pense pas qu'il soit plus dangereux qu'un autre métier, par exemple celui du charpentier qui est perché chaque jour en équilibre à plusieurs mètres au dessus de la terre et qui peut dégringoler à la moindre inattention. La vérité c’est que le journalisme est un métier doublement délicat. Une délicatesse qui tient de ce que le journalisme opère à la jonction d’enjeux parfois vitaux pour les autres acteurs de la société. Mais cette délicatesse tient surtout à une inadéquation entre la formation et l’emploi des journalistes. A savoir, ce pourquoi les journalistes sont formés et ce qu’ils sont amenés à faire effectivement sur le terrain.
De par la formation qu’il reçoit, le journaliste est dressé pour faciliter la circulation de l’information et dans une certaine mesure pour faire jaillir la vérité. Pour les puristes, il doit garder ses opinions au frigo et laisser parler les faits. Mais le journaliste étant aussi un acteur de la société la position de neutralité est souvent intenable. C’est pourquoi, il peut même aussi se permettre de dénoncer les travers des acteurs sociopolitiques. Dans cette posture de défenseur des droits de la l’homme et de la liberté, il a pour ambition de se mettre au service de la société. Il veut être la voix des sans voix. C’est en tout cas l’état d’esprit qui anime plus d’un journaliste qui sort d’une école de formation ou qui fait ses armes dans une rédaction pour ceux qui apprennent sur le tas. Remplir ces tâches devrait être pour lui, des objectifs à atteindre et à dépasser comme un champion qui courent après ses performances. Mais au bout du compte, qu’il aille à la presse officielle ou à la presse privée, une désillusion l’attend au bout du chemin.
Le drame du journaliste indépendant
Le journaliste est un homme constamment écartelé, déstabilisé même. Chacun de ses papiers a parfois valeur de sentence pour certaines personnes qui se sentent visées et qui sont parfois effectivement atteintes. Sans adopter systématiquement la démarche réflexive qui tue la créativité, le journaliste doit néanmoins prendre la mesure de sa responsabilité quant aux bouleversements que ses écrits peuvent provoquer au sein de la société. Pour ce faire, il doit tendre vers l’honnêteté, la justesse, ceci, dans la recherche de son propre épanouissement professionnel. L’expérience montre que l’épanouissement professionnel d’un journaliste est une fonction croissante du gap existant entre ses convictions et ses opinions personnelles et des positions que son journal lui fait adopter au quotidien dans sa production médiatique. C’est pourquoi, il existe dans les vieilles démocraties, la clause de conscience donnant la possibilité à un journaliste qui ne se retrouve plus dans la ligne éditoriale de son journal, de démissionner tout en bénéficiant d’un statut d’une personne licenciée.
Dans la presse officielle, certains journalistes qui sont pourtant grassement rémunéré et ont un accès facile à la bonne information – information étant synonyme de pouvoir - affichent paradoxalement un état dépressif qui les pousse souvent à se refugier dans l’alcool et tous les autres vices qui vont avec. Leurs rêves, c’est de quitter ce cadre professionnel où ils ont l’impression d’étouffer. Il en est ainsi de la vague des journalistes qui avait dû quitter la CRTV certainement pour être en phase avec leur conscience. Les plus connus s'appellent : Jean Claude Ottou, Boh Herbert, Ntemfack Ofegue, Eric Chinje, Julius Wame, Innocent Chia, Denise Epote Durand, Willy Niba, Didier Oti, Zacharie Ngninman… Il s’agit de ceux qui sont parvenus à un niveau de conviction et d’opinion personnelle très élevé, ceux qui conduisent en dehors de leur travail quotidien une intense réflexion sur le fonctionnement du système qu’ils servent. Ils comprennent très vite qu’une fois sur deux, ils sont payés pour dissimuler l’information et pour mentir si possible. Une perspective qui leur est insupportable.
Ceux qui échappent à ces tourments et affichent un semblant d’épanouissement professionnel sont des journalistes de petite épaisseur convictionnelle, des « pense petit », des carriéristes comme on les appelle au Cameroun, ceux qui font ce qu’on leur demande sans se poser des questions. Et s’ils se posent quelques fois des questions, c’est surtout celles de savoir ce qu’ils feront pour faire plaisir à leur patron et si possible monter en grade. Mais il faut se garder de croire que ces derniers sont les moins intelligents. Ils sont même parfois les plus intelligents, sauf qu'ils mettent leur intelligence au service de leurs seuls intérêts. En guise de récompense, ils reçoivent souvent des promotions en dehors de la profession de journaliste qu'ils n'hésitent pas à piétiner. Ils regardent leurs anciens confrères avec commisération en leur demandant de descendre de leur nuage pour goutter aux délices de la carrière.
Cet état d’esprit dans la presse officielle au Cameroun est un double héritage de l’ancien régime du parti unique et de l’affrontement qui opposa au début des années 1990 les journalistes de la presse privée au pouvoir. Du coup, pour accéder dans un organe de presse dit officiel, il fallait montrer patte blanche. C’est ce qu’avait expérimenté le journaliste Akwanka Joe Ndifor lors de sa prise de service à Radio Cameroun au milieu des années 1980 : « Le rédacteur en chef m’avait pris par la main pour m’emmener vers le tableau d’affichage. Là bas, il m’a fait lire un communiqué sur lequel il était écrit ceci : ne jamais parler d’un coup d’Etat survenu dans un pays voisin ; ne jamais rapporter une manifestation publique. J’ai tout de suite compris que je ne ferai jamais le journalisme tel que je l’ai rêvé ou si je souhaitais le faire ainsi, ce serait au prix d’un combat où je risque tout ».
Son combat, on le sait, Akwanka Joe Ndifor l’a mené au sein de l’émission « minute by minute » où, en compagnie d’autres rêveurs tels Julius Wame, Boh Herbert, Ntemfack Ofegue, Charly Ndi Chia, Ebsy Ngum il a tenté avec des fortunes diverses de gagner des espaces de liberté afin d’asseoir l’indépendance du journaliste au sein de la presse officielle. Un combat fratricide avant d’être un combat pour plus de liberté et marqué par cette phrase de défiance : « The news end where we begin ». Combat évidemment perdu puisque tous ces journalistes ont été contraints de quitter le bateau CRTV (Radio télévision camerounaise) qui les employait. Si l’on peut accorder une quelconque pertinence à l’adage qui dit que « partir c’est mourir un peu », nous pouvons dès lors affirmer qu’en partant, ces journalistes sont morts un peu pour le téléspectateur camerounais. C’est vrai que certains comme Ebsy Ngum et Akwanka Joe Ndifor sont réellement passé de vie à trépas. Comme le seront plus tard d’autres : Atemebang Achu Peter, Luc Ananga…
D’autres journalistes de la presse officielle qui, en composant avec leur conscience n’ont engagé aucun combat, ou qui passaient leur temps à railler les autres engagés dans ce combat, n’en sont pas moins aujourd’hui eux aussi atteint et déstabilisé. Ils se croyaient immunisés et pensaient que le mal n’était pas extérieur mais se trouvait au sein même de ceux qui éprouvaient le mal être. C’est la dialectique du cacao et du café. Sans soutien pouvant leur permettre de fructifier leur carriérisme par le biais d'une promotion juteuse, ils sombrent dans la rancœur, le négativisme et l'autodestruction. Lorsque, de passage au Cameroun récemment, j’ai demandé les nouvelles de certains aînés de cette presse officielle qui pourtant étaient au firmament de leur gloire il y a seulement quelques années, un ami a eu une formule décapante pour me dire ce qu’ils sont devenus : « Moi-même je ne les vois plus, du moins, plus à l'écran de la télévision où ils devraient être. Mais on m’a dit qu’on voit souvent leurs fantômes en train de boire chaque soir dans un bar du rond point Nlongkak », m’avait-il dit. S’il parle de fantômes, c’est parce qu’il considère que les journalistes qu’il avait connu sont déjà morts. Ce sont en fait ceux qu’on appelle des morts-vivants. Ceux qui, pendant le procès de la profession, ont été condamné à la perpétuité. Ils trimballent désormais leurs silhouettes partout mais ils n’existent plus pour personne. Un état qui doit plus difficile à supporter que celui des vrais morts qui eux sont partis et ne ressentent plus rien. Et d'ailleurs, comme le soutient Célestin Monga, "la mort n'est qu'une sorte de fenêtre sur l'autre vie".
Dans la presse privée, le journaliste a la possibilité de révéler si ce n’est l’ensemble mais la majorité des informations qui lui tombe sous la main. Mais il constate que très peu de choses lui sont accessibles parce que son média ne dispose pas des moyens d’investigation conséquents. Une difficulté qui est presque doublée dans un système fermé tel que savent l’être les systèmes en Afrique. Alors, faute d’informations, il est obligé de rafistoler et de procéder parfois par spéculation pour renseigner le grand public. Il n’est pas fier de son travail et peut déprimer de ce fait. De leur coté aussi, les lecteurs remarquent ces carences et décampent. Ce qui réduit l’influence des journalistes au sein de l’opinion et entraine une mort symbolique aux yeux des fans qui ne comprennent plus leur idole. Il faut dire que pour les trois quotidiens privés camerounais, aucun ne tire à 50 000 exemplaires. Ce qui relève de la pathologie pour un pays de près de 20 millions d’habitants et où le taux d’alphabétisation de près de 80% est l’un des plus élevés d’Afrique.
L’autre désillusion attend souvent le journaliste de la presse privée à la fin du mois lorsqu’à la place du salaire, son patron lui recommande souvent la patience et le courage. Le patron qui le demande souvent meurt aussi symboliquement pour des journalistes qui, en venant travailler chez lui, avaient une image particulière de lui, laquelle image s’éteint avec les atermoiements du patron. De même, le journaliste qui, faute de moyens, ne parvient pas à accéder au statut social dont le crédite l'imaginaire collectif, finit par mourir dans les rêves des membres de ka société. Malgré la bonne volonté qu’il mettait à vouloir résoudre ce problème là, Pius Njawe est mort sans régler les quelques 7 mois d’arriérés de salaires que le journal « Le Messager » devait à ses journalistes. Lorsque j’ai lu le témoignage de Célestin Ngoa Mballa j’ai compris que c’est la pudeur qui l’a empêché de réclamer ses piges au désormais défunt Pius Njawe. Il coulait de source que pour lui, et d’ailleurs peut-être pour certains de ses collègues, le patron Njawe était déjà un peu mort en eux avant même que de mourir par accident.
Comme nous pouvons le voir, qu’il soit employé dans la presse officielle ou dans la presse privée, le journaliste camerounais peine à échapper à la mort réelle ou symbolique. Quelque chose doit être fait pour mettre fin à cette hécatombe des journalistes au Cameroun et permettre à la profession d’apporter sa part dans la consolidation de la société démocratique. La mort de l’icône Pius Njawe pourrait servir à cela. Au moins de là où il se trouve actuellement, il sera content de voir l’accomplissement d’un chantier qu’il avait lui-même entamé.
Au-delà de la mort
Si je considère que Pius Njawe a eu à accomplir sur terre l’œuvre qui était la sienne dans la limite du temps à lui accordée et que la profession des journalistes dont il était finalement l’un des patriarches, la nation camerounaise toute entière et d’ailleurs le monde entier lui a rendu un hommage mérité, j’ai presque envie de dire, maintenant que Pius accomplit son dernier voyage vers l’éternité : laissons les morts et les anges continuer cette œuvre et occupons-nous des morts-vivants au moins pour tenter de les ressusciter et donner enfin un sens à la profession de journaliste au Cameroun. Et je pense que Pius lui-même accomplissait déjà cette œuvre humaniste à travers ses multiples combats.
On ne doit pas mourir tout simplement parce qu’on a décidé de devenir journaliste. On ne doit pas être obligé de quitter son pays et rechercher l’épanouissement professionnel ailleurs parce qu’on est journaliste. On ne doit pas absolument renoncer à son indépendance pour rentrer dans les bonnes grâces de qui que ce soit. Et si le Cameroun a hérité de toutes ces perversions, c’est certainement à cause de ce qui s’est passé au début des années 1990. Ces années ont vu un affrontement particulièrement violent entre les journalistes et le pouvoir. Ce qui a contribué à pervertir les rapports qui doivent être ceux de la presse et d’un pouvoir au sein de la société démocratique. Cette guerre des tranchés idiote que certains se représentent toujours aujourd’hui et tentent de la faire durer pour les besoins de la cause, 20 ans après, est une sorte hypothèque posée sur la modernisation de la société camerounaise et la pacification des mœurs politiques. C’est cet esprit guerrière qui fait que les tenants du pouvoir classent systématiquement au rang de leurs ennemis, des journalistes de la presse privée et parfois ceux de la presse officielle qui marquent quelque tiédeur à défendre le régime.
C’est vrai que partout dans le monde, la presse contrôlant le pouvoir, les deux entités ne peuvent pas être des alliés. Ce qui n’est d’ailleurs pas souhaitable. Mais sans que cela s’apparente à de la connivence, le pouvoir et la presse doivent jouer en bonne intelligence en respectant des règles qui protègent la dignité et l’intégrité mutuelle. Il revient au pouvoir d’utiliser tous les moyens modernes de communication pour défendre sa position et convaincre l’opinion de la justesse de ses options. Au 21e siècle, il n’est plus possible de se protéger de la critique en tentant de museler la presse indépendante ou d’enfermer l’institution qu’est le président de la République dans une sorte de ghetto communicationnel et continuer à adopter des postures guerrières pour traiter des questions républicaines faisant intervenir la presse privée.
Si je considère que Pius Njawe a eu à accomplir sur terre l’œuvre qui était la sienne dans la limite du temps à lui accordée et que la profession des journalistes dont il était finalement l’un des patriarches, la nation camerounaise toute entière et d’ailleurs le monde entier lui a rendu un hommage mérité, j’ai presque envie de dire, maintenant que Pius accomplit son dernier voyage vers l’éternité : laissons les morts et les anges continuer cette œuvre et occupons-nous des morts-vivants au moins pour tenter de les ressusciter et donner enfin un sens à la profession de journaliste au Cameroun. Et je pense que Pius lui-même accomplissait déjà cette œuvre humaniste à travers ses multiples combats.
On ne doit pas mourir tout simplement parce qu’on a décidé de devenir journaliste. On ne doit pas être obligé de quitter son pays et rechercher l’épanouissement professionnel ailleurs parce qu’on est journaliste. On ne doit pas absolument renoncer à son indépendance pour rentrer dans les bonnes grâces de qui que ce soit. Et si le Cameroun a hérité de toutes ces perversions, c’est certainement à cause de ce qui s’est passé au début des années 1990. Ces années ont vu un affrontement particulièrement violent entre les journalistes et le pouvoir. Ce qui a contribué à pervertir les rapports qui doivent être ceux de la presse et d’un pouvoir au sein de la société démocratique. Cette guerre des tranchés idiote que certains se représentent toujours aujourd’hui et tentent de la faire durer pour les besoins de la cause, 20 ans après, est une sorte hypothèque posée sur la modernisation de la société camerounaise et la pacification des mœurs politiques. C’est cet esprit guerrière qui fait que les tenants du pouvoir classent systématiquement au rang de leurs ennemis, des journalistes de la presse privée et parfois ceux de la presse officielle qui marquent quelque tiédeur à défendre le régime.
C’est vrai que partout dans le monde, la presse contrôlant le pouvoir, les deux entités ne peuvent pas être des alliés. Ce qui n’est d’ailleurs pas souhaitable. Mais sans que cela s’apparente à de la connivence, le pouvoir et la presse doivent jouer en bonne intelligence en respectant des règles qui protègent la dignité et l’intégrité mutuelle. Il revient au pouvoir d’utiliser tous les moyens modernes de communication pour défendre sa position et convaincre l’opinion de la justesse de ses options. Au 21e siècle, il n’est plus possible de se protéger de la critique en tentant de museler la presse indépendante ou d’enfermer l’institution qu’est le président de la République dans une sorte de ghetto communicationnel et continuer à adopter des postures guerrières pour traiter des questions républicaines faisant intervenir la presse privée.
Les vieux démons
Qu’on l’aime ou pas, il faut reconnaître que cette presse privée, nonobstant ses tares, garde la confiance d’une partie très importante de la population pour qui elle construit l’opinion. Il y a à Douala par exemple, plusieurs foyers qui se sont déconnectés volontairement du réseau CRTV en guise de protestation pour cette télévision qui selon elles, ne montrerait que les meetings du RDPC, le parti au pouvoir. Depuis, ces populations révoltées se régalent en regardant les chaines de télévisions privées où entre autre chose, il est question de cultiver la haine contre le régime présenté comme la source de tous les malheurs. Une haine qui, parce qu’elle ne peut être transfiguré en source de mobilisations sociales, contribue plutôt à détruire leurs porteurs un peu comme si, suite à un phénomène incompréhensible, les serpents et tous les autres bestioles à venin, se mettaient à mourir, empoisonnés par leur propre poison. En guise de réaction, dans certains médias publics et de préférence en langue locale ainsi que certains journaux satellites du pouvoir tentent eux aussi de cultiver la haine des ennemis du pouvoir et de la rediriger vers les cultivateurs de la haine du pouvoir dans un mécanisme de retour à l’envoyeur. Un état d’esprit qui avait déjà prévalu pendant les années de braise de 1990. Il est prévisible que cette situation pourrait s’exacerber au cours de l’année électorale 2011.
20 ans d’affrontement ruineux entre le pouvoir et la presse avec une longue liste de victimes directs ou collatéraux, çà suffit ! Il est temps que toute la presse camerounaise sans distinction de bord se retrouve dans les mêmes valeurs, s’affranchissent des politiques pour bâtir ensemble les conditions de l’enracinement de la démocratie. Il est temps que la division artificielle entre presse publique et presse privée, longtemps dépassée sous d’autres cieux le soit aussi au Cameroun. On est journaliste, un point c’est tout. Il est temps que les acteurs politiques qui aspire à une société démocratique renoncent définitivement à l'intolérance qui de l'avis de Guy Hermet, "est un comportement nuisible et est à l'envers même du principe' démocratique. Il est temps que le gouvernement s’affranchisse de la peur ou de la haine du journaliste de la presse dite privée et considère ce dernier comme contribuant à la promotion du service public au même titre que les journalistes de la presse dite publique. Il est temps que le gouvernement joue son vrai rôle de régulateur de tout le secteur de la communication et non plus celui de juge au profit d’une seule partie censée lui servir de bouclier. Il y a lieu de tourner la page d’une période d’affrontement et poser les bases d’une nouvelle collaboration. Et pour le faire, il faut considérer que les années de braise ont constitué une crise politique dont il faut gérer la sortie. Et Michel Dobry nous dit "qu'il faut éviter les sorties de crises qui jettent l'anathème sur une partie de la population ou qui vont absolument faire porter la responsabilité à une personne ou à un groupe de personnes puisque par là, on sème la graine de discorde qui aboutira à d'autres crises".
Le champ politique camerounais en général qui est "un terrain émotionnel propice au conflit" doit lui aussi s’affranchir de certaines conceptions héritées de la période trouble du début des années 1990 et qui faisait ou font d’ailleurs encore croire à plus d’un dirigeant que le service public veut dire service de la fonction publique. C’est cet affranchissement qui nous fera comprendre qu’un journal privé remplit lui aussi des missions de service public. Comme un fondateur d’un établissement scolaire privé, un promoteur d’un journal privé accomplit des tâches de service public que le pouvoir seul ne peut accomplir sans être accusé de juge et parti.
Qu’on l’aime ou pas, il faut reconnaître que cette presse privée, nonobstant ses tares, garde la confiance d’une partie très importante de la population pour qui elle construit l’opinion. Il y a à Douala par exemple, plusieurs foyers qui se sont déconnectés volontairement du réseau CRTV en guise de protestation pour cette télévision qui selon elles, ne montrerait que les meetings du RDPC, le parti au pouvoir. Depuis, ces populations révoltées se régalent en regardant les chaines de télévisions privées où entre autre chose, il est question de cultiver la haine contre le régime présenté comme la source de tous les malheurs. Une haine qui, parce qu’elle ne peut être transfiguré en source de mobilisations sociales, contribue plutôt à détruire leurs porteurs un peu comme si, suite à un phénomène incompréhensible, les serpents et tous les autres bestioles à venin, se mettaient à mourir, empoisonnés par leur propre poison. En guise de réaction, dans certains médias publics et de préférence en langue locale ainsi que certains journaux satellites du pouvoir tentent eux aussi de cultiver la haine des ennemis du pouvoir et de la rediriger vers les cultivateurs de la haine du pouvoir dans un mécanisme de retour à l’envoyeur. Un état d’esprit qui avait déjà prévalu pendant les années de braise de 1990. Il est prévisible que cette situation pourrait s’exacerber au cours de l’année électorale 2011.
20 ans d’affrontement ruineux entre le pouvoir et la presse avec une longue liste de victimes directs ou collatéraux, çà suffit ! Il est temps que toute la presse camerounaise sans distinction de bord se retrouve dans les mêmes valeurs, s’affranchissent des politiques pour bâtir ensemble les conditions de l’enracinement de la démocratie. Il est temps que la division artificielle entre presse publique et presse privée, longtemps dépassée sous d’autres cieux le soit aussi au Cameroun. On est journaliste, un point c’est tout. Il est temps que les acteurs politiques qui aspire à une société démocratique renoncent définitivement à l'intolérance qui de l'avis de Guy Hermet, "est un comportement nuisible et est à l'envers même du principe' démocratique. Il est temps que le gouvernement s’affranchisse de la peur ou de la haine du journaliste de la presse dite privée et considère ce dernier comme contribuant à la promotion du service public au même titre que les journalistes de la presse dite publique. Il est temps que le gouvernement joue son vrai rôle de régulateur de tout le secteur de la communication et non plus celui de juge au profit d’une seule partie censée lui servir de bouclier. Il y a lieu de tourner la page d’une période d’affrontement et poser les bases d’une nouvelle collaboration. Et pour le faire, il faut considérer que les années de braise ont constitué une crise politique dont il faut gérer la sortie. Et Michel Dobry nous dit "qu'il faut éviter les sorties de crises qui jettent l'anathème sur une partie de la population ou qui vont absolument faire porter la responsabilité à une personne ou à un groupe de personnes puisque par là, on sème la graine de discorde qui aboutira à d'autres crises".
Le champ politique camerounais en général qui est "un terrain émotionnel propice au conflit" doit lui aussi s’affranchir de certaines conceptions héritées de la période trouble du début des années 1990 et qui faisait ou font d’ailleurs encore croire à plus d’un dirigeant que le service public veut dire service de la fonction publique. C’est cet affranchissement qui nous fera comprendre qu’un journal privé remplit lui aussi des missions de service public. Comme un fondateur d’un établissement scolaire privé, un promoteur d’un journal privé accomplit des tâches de service public que le pouvoir seul ne peut accomplir sans être accusé de juge et parti.
Des solutions existent
C’est vrai qu’une telle conception demande un peu plus de responsabilité de la part des journalistes qui doivent parvenir à la subtilité permettant de distinguer l’institution « président de la République » qu’on doit toujours protéger parce qu’elle valide la qualité même de l’Etat du Cameroun, de la personne qui incarne cette fonction et qu’on peut se permettre d’égratigner et même de vilipender sans conséquence grave. Cela recèle forcément une difficulté de discernement qu’il faut absolument surmonter dans l’intérêt supérieur de la nation. Mais on doit rester intransigeant sur le fait que nonobstant son rôle de critique de l’action gouvernementale, la presse privée apporte son concours à l’Etat dans l’accomplissement des missions de service public et que pour cela, cette presse doit bénéficier de la part de cet Etat – à ne pas confondre avec le gouvernement qui n’en est que l’émanation – d’abord le respect et considération et, ensuite des subventions conséquentes.
Toutefois, contrairement à ce qui se passe aujourd’hui et qui consiste en la distribution des espèces sonnantes et trébuchantes – ce qui peut avoir des relents de corruption et d’achat des consciences – il est question pour le gouvernement de reformer le secteur de la communication pour permettre aux entreprises de presse de tirer meilleure partie. Il en est ainsi du secteur de la publicité qui reste une véritable jungle au Cameroun. Il est aussi question pour le gouvernement d’ouvrir la communication présidentielle à la presse privée sans complexe aucun. Il faut savoir que lorsqu’on entrevoit une scène à travers une petite faille, on en fait un commentaire plus exalté que si on avait largement la porte ouverte. Il faut que le président de la République, désormais investit de son statut d’institution républicaine, puisse embarquer des journalistes de la presse privée lors de ses voyages officiels quoique cela lui coûte. Evidemment, au début, ce sera difficile à cause de la suspicion compréhensible mais il faut y aller à la difficulté parce que la vie n’est pas faite que des choses faciles. Dans un contexte où de l’avis de Jean Mouchon, « le chef de l’Etat doit désormais composer et non plus s’imposer » le président de la République devrait pouvoir choisir un média privé, présentant les meilleurs taux d'audiences ciblées pour la livraison de son message. C'est un choix paresseux de la part du gouvernement que de renoncer à affronter une presse même hostile.
D’autres actions viseront la réduction des coûts de fabrication des journaux. Une autre subvention pourrait consister en la mise à la disposition des journaux privés des journalistes de la presse officielle et tous ceux qui se tournent les pouces au ministère de la Communication. Ceci aura un double avantage : permettre aux journaux privés de bénéficier d’une expertise nouvelle et permettre en retour aux journalistes des médias officiels qui étouffent du fait de ce fameux gap entre leurs opinions et ce qu’on leur fait faire, de trouver quelque soupape de respiration professionnelle. Il restera juste un problème de loyauté qu’on peut facilement régler si les gouvernants abandonnent leur frilosité et voient en un journal non plus une entreprise de terreur mais une structure d’encadrement. Ils comprendront alors que comme un collège privé qui emploie en vacation les professeurs de lycée, un journal privé peut aussi s’offrir les services d’un journaliste gouvernemental. C’est à ce prix seulement qu’on aura certainement au Cameroun une démocratie digne de ce nom et que le mot journaliste ne rimera plus avec la mort.
Etienne de Tayo
Promoteur « Afrique Intègre »
http://www.edetayo.blogspot.com/
C’est vrai qu’une telle conception demande un peu plus de responsabilité de la part des journalistes qui doivent parvenir à la subtilité permettant de distinguer l’institution « président de la République » qu’on doit toujours protéger parce qu’elle valide la qualité même de l’Etat du Cameroun, de la personne qui incarne cette fonction et qu’on peut se permettre d’égratigner et même de vilipender sans conséquence grave. Cela recèle forcément une difficulté de discernement qu’il faut absolument surmonter dans l’intérêt supérieur de la nation. Mais on doit rester intransigeant sur le fait que nonobstant son rôle de critique de l’action gouvernementale, la presse privée apporte son concours à l’Etat dans l’accomplissement des missions de service public et que pour cela, cette presse doit bénéficier de la part de cet Etat – à ne pas confondre avec le gouvernement qui n’en est que l’émanation – d’abord le respect et considération et, ensuite des subventions conséquentes.
Toutefois, contrairement à ce qui se passe aujourd’hui et qui consiste en la distribution des espèces sonnantes et trébuchantes – ce qui peut avoir des relents de corruption et d’achat des consciences – il est question pour le gouvernement de reformer le secteur de la communication pour permettre aux entreprises de presse de tirer meilleure partie. Il en est ainsi du secteur de la publicité qui reste une véritable jungle au Cameroun. Il est aussi question pour le gouvernement d’ouvrir la communication présidentielle à la presse privée sans complexe aucun. Il faut savoir que lorsqu’on entrevoit une scène à travers une petite faille, on en fait un commentaire plus exalté que si on avait largement la porte ouverte. Il faut que le président de la République, désormais investit de son statut d’institution républicaine, puisse embarquer des journalistes de la presse privée lors de ses voyages officiels quoique cela lui coûte. Evidemment, au début, ce sera difficile à cause de la suspicion compréhensible mais il faut y aller à la difficulté parce que la vie n’est pas faite que des choses faciles. Dans un contexte où de l’avis de Jean Mouchon, « le chef de l’Etat doit désormais composer et non plus s’imposer » le président de la République devrait pouvoir choisir un média privé, présentant les meilleurs taux d'audiences ciblées pour la livraison de son message. C'est un choix paresseux de la part du gouvernement que de renoncer à affronter une presse même hostile.
D’autres actions viseront la réduction des coûts de fabrication des journaux. Une autre subvention pourrait consister en la mise à la disposition des journaux privés des journalistes de la presse officielle et tous ceux qui se tournent les pouces au ministère de la Communication. Ceci aura un double avantage : permettre aux journaux privés de bénéficier d’une expertise nouvelle et permettre en retour aux journalistes des médias officiels qui étouffent du fait de ce fameux gap entre leurs opinions et ce qu’on leur fait faire, de trouver quelque soupape de respiration professionnelle. Il restera juste un problème de loyauté qu’on peut facilement régler si les gouvernants abandonnent leur frilosité et voient en un journal non plus une entreprise de terreur mais une structure d’encadrement. Ils comprendront alors que comme un collège privé qui emploie en vacation les professeurs de lycée, un journal privé peut aussi s’offrir les services d’un journaliste gouvernemental. C’est à ce prix seulement qu’on aura certainement au Cameroun une démocratie digne de ce nom et que le mot journaliste ne rimera plus avec la mort.
Etienne de Tayo
Promoteur « Afrique Intègre »
http://www.edetayo.blogspot.com/